MERVEILLES1 STACK008
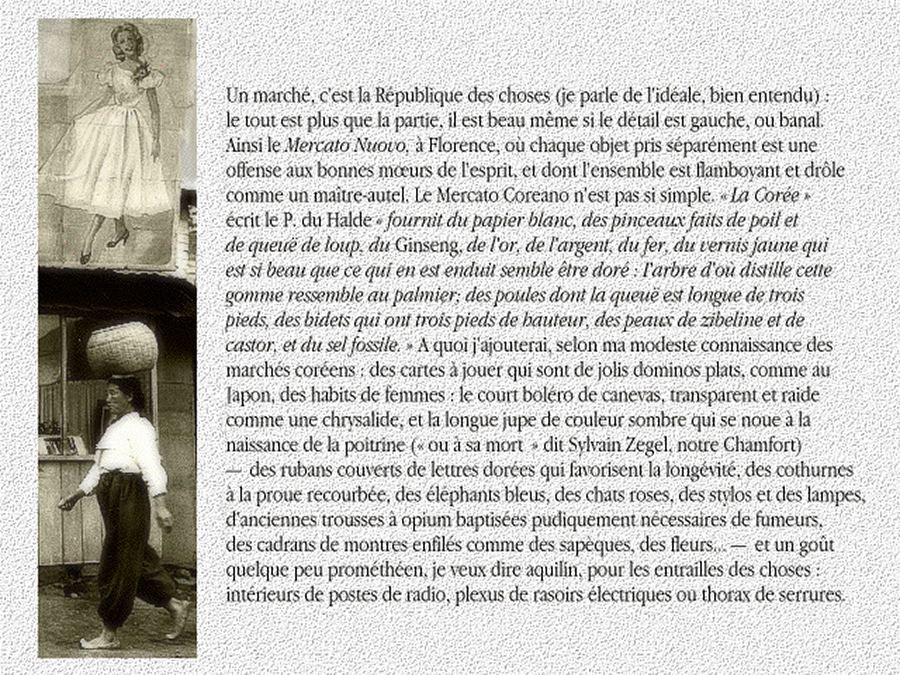
- Id : 841
- Catégorie : PHOTO
- Séquence : Coréennes_Merveilles1
- Card : MERVEILLES1 STACK008
Navigation :
Médias :
Pas de vidéoPas de son
Texte :
Un marché, c'est la République des choses (je parle de l'idéale, bien entendu) :
le tout est plus que la partie, il est beau même si le détail est gauche, ou banal.
Ainsi le Mercato Nuovo, à Florence, où chaque objet pris séparément est une
offense aux bonnes mœurs de l'esprit, et dont l'ensemble est flamboyant et drôle
comme un maître-autel. Le Mercato Coreano n'est pas si simple. « La Corée »
écrit le P. du Halde « fournit du papier blanc, des pinceaux faits de poil et
de queue de loup, du Ginseng, de l'or, de l'argent, du fer, du vernis jaune qui
est si beau que ce qui en est enduit semble être doré : I'arbre d'où distille cette
gomme ressemble au palmier; des poules dont la queuë est longue de trois
pieds, des bidets qui ont trois pieds de hauteur, des peaux de zibeline et de
castor, et du sel fossile. » A quoi j'ajouterai, selon ma modeste connaissance des
marchés coréens : des cartes à jouer qui sont de jolis dominos plats, comme au
Japon, des habits de femmes : le court boléro de canevas, transparent et raide
comme une chrysalide, et la longue jupe de couleur sombre qui se noue à la
naissance de la poitrine («ou à sa mort» dit Sylvain Zegel, notre Chamfort)
— des rubans couverts de lettres dorées qui favorisent la longévité, des cothurnes
à la proue recourbée, des éléphants bleus, des chats roses, des stylos et des lampes,
d'anciennes trousses à opium baptisées pudiquement nécessaires de fumeurs,
des cadrans de montres enfilés comme des sapèques, des fleurs... — et un goût
quelque peu prométhéen, je veux dire aquilin, pour les entrailles des choses :
intérieurs de postes de radio, plexus de rasoirs électriques ou thorax de serrures.